Le 5 mars 2016, j’ai été invité à m’exprimer à l’Universitaire populaire albanaise, en tant que Président de l’Association des Communes Genevoises et Maire de Vernier chargé de la cohésion sociale et de l’emploi, sur les difficultés et discrimination dans le domaine de l’employabilité. Voici ci-dessous quelques unes de mes réponses aux questions posées.
Quelles sont les difficultés spécifiques rencontrées par les populations étrangères en matière d’insertion professionnelle?
Tout dépend, comme souvent. De quoi? Du pays d’origine, du permis de séjour/ travail, du contexte migratoire (raison de la migration), du réseau de la personne sur place (familial, communautaire, professionnel), de l’âge, du genre, de la situation familiale, du niveau de formation, de la couleur de peau, de l’appartenance religieuse, du secteur professionnel visé, de la conjoncture économique, etc.
La liste est longue… et vous voyez qu’il n’y a final que peu d’éléments sur lesquels la personne concernée a une emprise. Beaucoup de ces «freins à l’emploi», appelons-les comme ça, ne concernent pas que les personnes d’origine étrangère. Car le marché de l’emploi est impitoyable, très concurrentiel, et que les moindres écarts à certaines normes peuvent rendre quelqu’un indésirable.
Je dirais que les difficultés qui sont spécifiques à cette vaste catégorie que sont les «migrants» sont : celles liées au statut (permis), à la maîtrise du français (bien que ce problème concerne aussi certains locaux…) et l’image que l’on porte, et qui laisse justement beaucoup de place à différents types de discrimination.
Observe-t-on des différences entre des jeunes issus de la migration d’après-guerre (secondos ou enfants de secondos italiens, espagnols, portugais) et les migrations plus récentes de l’Est de l’Europe?
Bien sûr qu’il y a des différences, comme il y a des différences en matière d’intégration entre les différentes populations de travailleurs saisonniers que vous citez comme exemple dans votre question. Les Portugais se sont intégrés à Genève de manière complètement différente que les Italiens, par exemple. Les jeunes de la seconde vague migratoire que vous évoquez, albanais par exemple, ont probablement dû faire face aux même type de discours discriminants que les Espagnols à leur époque, mais dans une conjoncture économique aujourd’hui peut-être plus dure, à une époque où la formation s’est largement démocratisée et les trajectoires professionnelles individualisées, dans une société genevoise déjà bien plus pluriculturelle, avec des modèles d’intégration qui semblent peut-être plus accessibles.
Mais attention : je ne veux en aucun cas comparer la difficulté ou la pénibilité des efforts que les uns ou les autres ont dû endurer. L’insertion professionnelle est sans aucun doute facilitée par l’intégration sociale. Les jeunes d’origine étrangère, quelle que soit cette origine, qui sont nés à Genève, dont les parents parlent français, ont un réseau, une implication dans la société locale, possèdent bien entendu une bien meilleure base pour se développer professionnellement que d’autres qui viendraient d’arriver en suisse, aussi compétents et volontaires soient-ils.
Quelles sont les difficultés spécifiques des migrants extra-européens, en particulier ceux dont le statut juridique est intrinsèquement vulnérable (sans papiers et requérants d’asile) ?
La réponse est dans votre question: les difficultés résident principalement dans les questions de statut. Certains permis permettent aux personnes qui en sont détentrices de travailler moyennant une demande d’autorisation auprès de l’OCPM (par exemple, les permis F). Néanmoins, les employeurs, qui ont la responsabilité d’entreprendre ces démarches administratives, rechignent à le faire, de peur de la lourdeur qu’elles peuvent représenter. Par ailleurs, symboliquement, le caractère « éphémère » (souvent faussement éphémère – les personnes restent des années en Suisse) de certaines autorisations de séjour, décourage les parties prenantes de s’investir, du côté des employeurs, comme du côté des employés. Là, l’administration pourrait me semble-t-il faire un effort de simplification, de communication, et peut-être même de médiation. Tout le monde aurait à y gagner.
L’autre aspect pour les populations extra-européennes concerne à nouveau l’image. Le monde s’ouvre, notre regard se globalise, mais certaines personnes restent accrochées à certaines images fortement ancrées, et pensent par exemple qu’un homme de couleur serait moins adéquat pour un poste de réceptionniste qu’une Suissesse. Ces pensées sont tenaces, et il faudra plusieurs générations et une multiplication de contre-exemples pour qu’elles s’effacent.
Que peuvent faire les communes/ villes ? Comment pallier aux insuffisances de l’Office cantonal de l’emploi ? Revaloriser les formations qualifiantes et les passerelles ? Supprimer les stages de réinsertion ? Promouvoir une culture de la solidarité et de la revendication ?
Le problème du chômage est un problème complexe, que ce soit celui des personnes étrangères ou non. Il n’y a pas de solutions miracle. Mais il y a des solutions, aujourd’hui déployées, qui montrent leurs limites. Ma conviction, c’est qu’on ne peut plus rester dans l’illusion que des programmes ou des protocoles de prise en charge, standardisés, puissent répondre de manière pertinente à l’ensemble des situations tant elles sont diverses. Appliquer à tout le monde le même traitement, ce n’est ni de l’équité ni de l’économie sur le plan des coûts publics. Car les personnes qui sortent du chômage pour basculer vers l’aide sociale disparaissent des statistiques, mais pas du réseau institutionnel.
Calculer, pour utiliser un terme un peu froid, ce que « coûte » à la collectivité une personne qui est trimbalée d’une institution à l’autre n’est pas évident et je conçois que ce soit dans ce contexte difficile de se déterminer sur que l’on est prêt à investir en plus. Mais une chose est sûr, c’est que travailler à sortir les personnes de la précarité, leur donner les moyens de redevenir actrices de leur existence, cela demande du temps et de l’attention. Il y a beaucoup de mesures d’insertion, dont celles que vous citez, qui ont été mis en place avec de bonnes intentions, mais dont l’application se révèle malheureuse. Pourquoi ? Parce qu’une mesure n’a de sens que si elle est intégrée à un accompagnement plus global. Les stages peuvent être de fabuleux outils, s’ils sont bien préparés, supervisés, mis en perspective avec l’ensemble du parcours de la personne. Et ce travail demande du temps une certaine souplesse, conditions que les professionnels du social n’ont plus, ni à l’HG, ni à l’OCE, mais que nous essayons dans les communes de conserver. Prenons l’exemple des stages d’évaluation, outils central du dispositif d’insertion cantonal.
Je comprends l’idée qu’il y a derrière, et le fantasme de pouvoir trouver un moyen pour sonder les personnes, identifier leurs forces et faiblesses, pour ensuite pouvoir les orienter vers un suivi plus adapté à leurs besoins. La réalité n’est pas aussi simple : ces stages, obligatoires, sont vécus comme des moments violents, de tri massif, qui servent à enfermer les gens dans des catégories, aussi brutalement binaires qu’ « être apte » ou « pas apte » à travailler. L’action que nous menons dans certaines communes pourrait très bien être menée par le canton, moyennant, certes, des moyens supplémentaires en matière de ressources humaines. Le principe est simple : revenir à suivi personnalisé, tant au niveau des objectifs que des moyens déployés pour le faire. Les évaluations se font également, dans le cadre de stages en entreprise par exemple. Les personnes sont dans ce cas parties prenantes, et les entreprises aussi, ce qui a l’avantage de pouvoir provoquer des rencontres et déboucher sur des opportunités. La formation est bien sûr centrale aussi.
La formation professionnelle, notamment, pour laquelle on doit faire évoluer les mœurs et pratiques (ouvrir ces formations à des adultes), ou encore validation d’acquis. Le développement ou la valorisation de nouveaux cursus, qui tiennent comptes des changements sociaux et des secteurs de l’économie porteurs en matière d’emploi, est une autre piste. Il faut également, me semble-t-il soutenir d’avantage les projets de réorientation professionnelle, qui sont pour certaines personnes parfois très pertinent, voir dans certaines situations indispensables. Et peut-être, soyons un peu utopistes, imaginer découpler la question de l’indemnisation des chômeurs de celle de leur accompagnement, et arrêter avec le principe de la carotte et du bâton, qui ne responsabilise et ne motive que rarement les individus. Et les collectivités publiques sont par ailleurs des employeurs, aussi, qui à mon avis ont encore beaucoup d’efforts à faire pour appliquer à l’interne certaines valeurs prônées. Je parle par exemple de l’accueil de stagiaires, d’apprentis, l’ouverture des services RH à des profils de travailleurs de plus de 50 ans, de femmes au retour d’une période éducative, de personnes en reconversion professionnelle et partiellement « invalides », de personnes d’origine étrangère, aussi.
Pour finir, je dirais que notre société et les institutions devraient apprendre à s’ouvrir à singularité, en réalisant que c’est elle qui nous fait avancer.
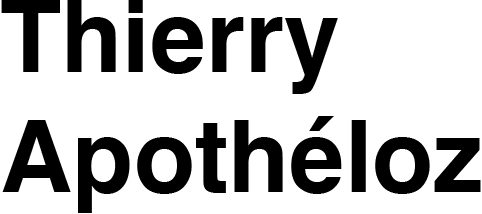




[…] Les deux autres ont débattu d’appartenances religieuses et vivre ensemble ainsi que de difficultés et discrimination dans le domaine de […]
[…] Les deux autres ont débattu d’appartenances religieuses et vivre ensemble ainsi que de difficultés et discrimination dans le domaine de […]